Quand la peinture inspire le cinéma
- Antoine Gros

- 8 janv. 2024
- 12 min de lecture
Dernière mise à jour : 25 avr. 2024
Extrait de Tiens, tiens... N°2
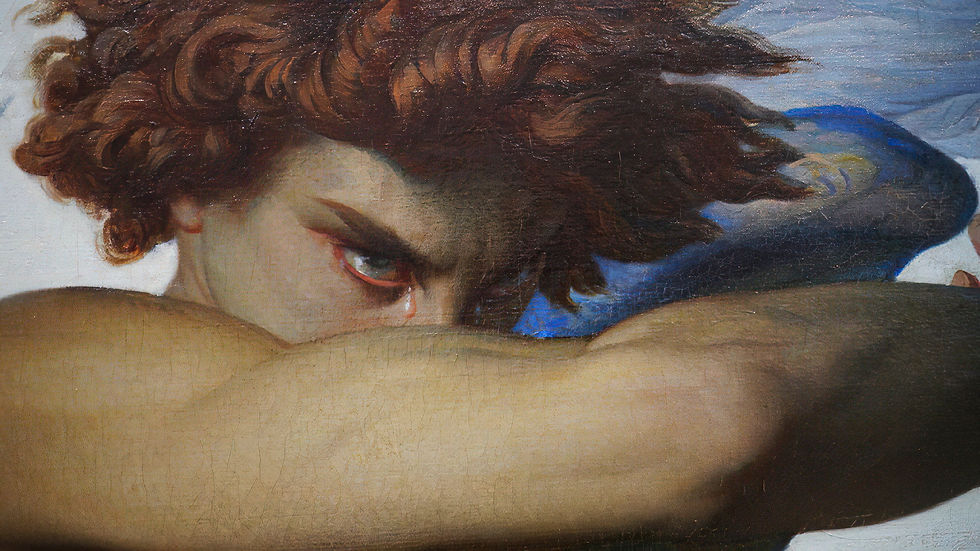


Le cinéma, s’il est un art à part entière comme l’indique sa dénomination de 7ème art, est le plus récent d’entre eux, et par conséquent, le plus à même de s’inspirer d'œuvres culturelles déjà existantes. Si, lorsque l’on pense aux œuvres qui inspirent le cinéma depuis toujours, les premières auxquelles on pense sont les œuvres littéraires, tant le cinéma les a adaptées au fil du temps, nous allons aujourd’hui voir comment le 7ème art s’inspire du 3ème, qui regroupe tous les arts visuels, et plus particulièrement la peinture.

D’une manière générale, et pour faire simple, la peinture a depuis toujours inspiré les différentes générations de réalisateurs et autres metteurs en scène lors de la création de leurs œuvres. Cette inspiration, qui continue encore aujourd’hui, se manifeste sous diverses formes, et la plus importante, car la plus flagrante, est celle de la reproduction : il n’est pas rare qu’un cinéaste reproduise le temps d’une scène, ou même d’un simple plan, un tableau en particulier. Il existe des dizaines d'exemples, et chacun témoigne de la façon qu’à le monde du cinéma de s’inspirer de celui de la peinture. Ces scènes, tant leur affiliation avec la peinture est grande, sont souvent pensées par les réalisateurs comme un hommage tout d’abord, comme une citation visuelle ; une manière de témoigner leur amour pour une toile en particulier, ou encore pour apporter une nouvelle dimension à leur scène, donnant à cette dernière un degré supérieur d’analyse. C’est exactement ce que fait Paul Thomas Anderson dans Inherent Vice (2014) , lorsqu’il reproduit le célèbre tableau La Cène avec les personnages de son film, ou encore Martin Scorsese lorsqu’il imite la toile de Gustav Klimt The Kiss dans Shutter Island (2010). Des inspirations directes, qui offrent souvent de magnifiques plans, tout en donnant une profondeur nouvelle aux scènes, propices à de nombreuses analyses faisant les liens entre les thématiques du tableau et celles du film en question. Sans aller dans la citation explicite, il arrive également que des personnages de tableau, ou des scènes représentées, servent d’inspirations à des réalisateurs lorsqu’il s’agit de créer une nouvelle œuvre, ou de donner vie à un personnage en particulier. Citons par exemple la manière dont le réalisateur Christopher Nolan s’est inspiré du travail de Francis Bacon lorsqu’il a créé sa propre version du Joker, le némésis de Batman, magistralement interprété par Heath Ledger dans The Dark Knight (2008). Un personnage et une prestation qui valurent à l'interprète un Oscar posthume pour le rôle, et qui permettent à l'œuvre de Bacon de continuer à vivre, au-delà de son tableau.


Car en effet, si la reproduction, fidèle ou non, d’un tableau dans un film est le type d’inspiration qui vient en premier lorsque l’on aborde ce sujet, le monde de la peinture inspire le cinéma de bien d’autres manières, comme nous allons pouvoir le voir par la suite.Tout d’abord, nous pouvons citer l’inspiration générale : il n’est pas rare que lors de l’élaboration d’un long métrage, un réalisateur s’inspire des travaux d’un peintre en particulier, pour donner à son film une esthétique particulière. C’est notamment le cas du cinéaste Wim Wenders, qui affirme avoir grandement été inspiré par le peintre Edward Hopper tout au long de sa carrière. Un peintre qui en a inspiré plus d’un, comme en témoigne l’hommage que lui fait Herbert Ross dans Pennies from Heaven, en reproduisant un de ses tableaux. Wenders est fasciné par l’univers que crée Hopper à travers ses tableaux, et s'imprègne de l’ambiance qu’ils dégagent lors de la réalisation de ses propres films. Comme pour boucler la boucle, Wim Wenders réalise en 2020 un court métrage en 3D, intitulé Two or Three Things I Know About Edward Hopper, qui plonge le spectateur au cœur des peintures de l’américain.




Si, comme nous l’avons vu précédemment, lorsqu’un film reproduit un tableau, il s’agit souvent d’un témoignage de la filiation thématique entre ces derniers, il existe des situations où la reproduction d’une scène est moins abstraite, et sert même directement le propos du film : c’est le cas des biopics d’artiste. Le film racontant la vie d’un artiste, il est alors logique que l’on aperçoive le travail de ce dernier, et alors, recréer une œuvre de cet artiste au sein même du film devient logique : l’évocation de l’œuvre originale est bien plus évidente, et il n’est plus question ici de faire le lien entre des thématiques ou simplement une inspiration de réalisation, mais de réellement placer le film dans un contexte historique. C’est le cas par exemple dans le film Frida (2002), où Julie Taymor reproduit le célèbre autoportrait de Frida Kahlo et son mari. Une manière d’ancrer le film dans la réalité, tout en étant l’occasion pour la réalisatrice d’offrir un très joli plan, jouant sur la composition de l’image pour être au plus près de l'œuvre originelle.


En ce qui concerne Frida Kahlo, nous pouvons aussi citer la façon dont son œuvre a pu inspirer plusieurs cinéastes. C’est le cas de Luc Besson notamment, qui, lorsqu’il créa l’univers du film Le Cinquième Élément (1997), se servit du tableau La Colonne Brisée pour donner à Leelo, l'héroïne du film, ses traits physiques. Citons également les équipes des studios Pixar qui, lorsqu’elles créèrent l’univers visuel du long-métrage Coco (2017), puisèrent également dans les travaux de Frida Kahlo, le film se déroulant dans un cadre mexicain, propice à l’utilisation des œuvres de Kahlo comme base de travail. Frida fait partie de la longue liste des artistes qui inspirent leurs contemporains de manière plus ou moins grande et plus ou moins volontaire, lorsqu’il s’agit de donner à un film une identité visuelle forte. Mais parmi ces artistes à l’univers atypique, il en existe un autre, qui a lui aussi énormément inspiré le monde du cinéma.
Il s’agit de John Martin, un peintre anglais appartenant au courant du Romantisme. Ce dernier a énormément influencé le cinéma grâce à ses nombreuses œuvres représentant de larges paysages, parfois désolés ou même apocalyptiques, mais toujours avec le même sens de la composition et de la mise en scène, offrant alors de nombreuses scènes qui ne sont pas sans rappeler celles de films fantastiques. Et à juste titre, car ses travaux ont beaucoup inspiré de nombreux artistes spécialisés dans les effets spéciaux et les décors de films. C’est le cas notamment de Ray Harryhausen, un artiste ayant travaillé par exemple sur les effets spéciaux de Jason et les Argonautes (1963), ou encore du Septième Voyage de Sinbad (1958). Deux films aujourd’hui considérés comme des classiques du film d’aventures, qui ont évidemment eux aussi inspiré les générations suivantes d’artistes du cinéma. En ce qui concerne Ray Harryhausen, ce dernier explique que les compositions de Martin ont toujours eu beaucoup d'effets sur lui, et qu’il est logique que son travail ait été influencé, même inconsciemment, par la passion qu’il voue à l'œuvre de ce dernier.
Selon lui, il est normal de s’inspirer d'œuvres pour en créer des nouvelles, de manière à ce qu’à leur tour, les nouvelles œuvres en inspirent d’autres.

Comme dit précédemment, le monde du cinéma, et les artistes impliqués dans la création de films n’hésitent pas à puiser dans l’univers de la peinture pour y trouver de l’inspiration. Et s’il est vrai que se servir d’une toile déjà existante comme base de travail, que ce soit pour l'évoquer plus ou moins subtilement, ou seulement pour en conserver l’intention artistique, est déjà en soi une preuve du lien étroit qu’il existe entre ces deux disciplines, et la façon dont l’une peut influencer l’autre, cette connexion est en réalité bien plus profonde. Nous avons déjà abordé plusieurs cas de figure, que ce soit l’évocation visuelle, pour rappeler une toile en raison de thématiques communes, ou simplement y faire référence, ou alors la reproduction assumée, dans un contexte historique, ou même parfois parodique : tous ces cas de figure ne sont que la face visible de l’iceberg, les influences les plus évidentes de la peinture sur le cinéma. Des inspirations ponctuelles, qui reposent sur un tableau en particulier, un peintre, voire même un courant artistique, mais toujours sur des références bien précises. En réalité le cinéma, de par sa nature d'œuvre visuelle composée d'images, entretient des liens bien plus profonds avec le monde de la peinture, et la réflexion lors de l’élaboration d’un plan est semblable à celle du peintre qui imagine sa toile.

La réalisation d’une peinture passe, pour la plupart des artistes, par une réflexion précise en amont sur la façon dont les différents éléments vont s'agencer les uns par rapport aux autres, et comment chacun d'eux va servir le but du tableau. Cela peut être une recherche d’esthétisme de la part de l’auteur de la toile, mais également la transmission d’une émotion, ou même simplement la représentation la plus fidèle possible d’un élément réel, comme le faisaient beaucoup les peintres avant l’invention de la photographie. Ce travail de composition se fait en réfléchissant aux formes principales du tableau, aux zones de vide, aux zones denses, aux lignes de fuite, à la façon dont les éléments sont mis en valeur, etc. Tout un travail d’esthétisme, pour permettre à l'œuvre finale de transmettre au mieux les émotions voulues par l’artiste. Et c’est justement ce travail là que l’on retrouve au cinéma, sans même forcément y penser à première vue. Lorsqu’un réalisateur imagine un plan, il va effectuer la même réflexion qu’un peintre : comment agencer chacun des éléments dans l’espace, pour transmettre au mieux l’intention voulue ? Le réalisateur, souvent accompagné d’un directeur de la photographie, va élaborer chacun des plans de son film de manière à les rendre le plus efficace possible : qu’un plan soit beau lorsqu’il a besoin de l’être, facile à comprendre rapidement lorsque c’est nécessaire. Bien entendu, le cinéma, au contraire de la peinture, n’est pas figé, et un plan doit être imaginé sur trois dimensions, mais le résultat final est lui bel et bien rendu en deux dimensions, comme une succession de tableaux. Et c’est notamment en cela que le cinéma s’éloigne du théâtre : la vision d’un réalisateur entre en jeu, et le spectateur n’observe le jeu scénique qu’à travers les yeux dudit réalisateur. Cela passe évidemment par le montage, mais aussi par cette réflexion sur le cadrage et la création de plans.
Lorsqu’il peint La Création d’Adam, Michel-Ange y représente une scène aux inspirations bibliques : l’index d’Adam et celui de Dieu, qui se rejoignent sans se toucher, comme pour signifier que l’Homme peut s’approcher de Dieu, mais ne pourra jamais l’atteindre. Un tableau qui, au-delà de son apparence impressionnante, laisse libre cours à l’interprétation du spectateur. C’est l’exemple type de la réflexion en amont du peintre, qui a peut-être voulu représenter de la meilleure des manières la supériorité de Dieu sur l’Homme. Et l’exemple aurait pu s’arrêter là, et être déjà bien assez pertinent sur la façon dont la composition d’un tableau en permet l’analyse, mais en réalité, lorsque l’on regarde de près Dieu et le groupe divin qui compose la moitié droite du tableau, on peut se rendre compte qu’ils forment la silhouette d’un cerveau humain : cela permet une nouvelle analyse du tableau, où le divin pourrait alors représenter le savoir ou la connaissance, et insiste une nouvelle fois sur la façon dont il est possible, simplement à l’aide d’une bonne utilisation des codes de la peinture et de la composition visuelle, d’offrir à une toile plusieurs niveaux de lecture et de compréhension. C’est cette façon de concevoir un tableau qui inspire depuis toujours les cinéastes lors de l’élaboration de leurs plans. C’est par exemple ce que fait Zack Snyder, dans Man of Steel (2013), en représentant Superman à l’écran comme un dieu, en signifiant sa puissance à l’aide de la façon dont il le fait apparaître dans le cadre, qui n’est pas sans rappeler certaines toiles bibliques. Cette mise en scène, qui est avant tout l’occasion d’offrir aux spectateurs de magnifiques images, est également une manière d’appuyer le propos du film : comment un être aux pouvoirs divins peut-il vivre parmi les Hommes ? Ce travail, très présent sur certains plans iconiques du long métrage, n’est bien évidemment pas le même tout au long de celui-ci, et tous les plans ne sont pas pensés en amont de la même façon : si certains passages sont réfléchis minutieusement, d'autres ne sont filmés que de la façon la plus “pratique”. Et c’est le cas de tous les films, car si le cinéma peut être très proche en certains aspects de la peinture, chaque réalisateur n’accorde pas la même importance à l’esthétique de ses films.
Cependant, il existe certains réalisateurs qui accordent à l’apparence de leurs films une attention toute particulière, de telle sorte qu’il est parfois possible de reconnaître en un seul coup d'œil leurs travaux. C’est par exemple le cas du réalisateur américain Wes Anderson, qui est très connu pour la manière qu’il a de construire ses plans de façon très rectiligne, et travaillant également beaucoup sur l’asymétrie dans ses films. Parmi tant d’autres, nous pouvons également citer le français Michel Gondry, qui a, au fil des années, développé un style visuel unique, se reposant beaucoup sur une manière de filmer très “organique”, en effectuant un important travail sur la matière, en n’hésitant pas à mélanger parfois prises de vues réelles et animations en stop-motion, ou bien à utiliser des effets spéciaux pratiques proches du bricolage afin d’obtenir un rendu unique. Cela permet de créer des visuels très marquants, et d’offrir des scènes ressemblant parfois à des tableaux surréalistes. Lorsqu’il réalisa son chef-d’œuvre Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2002), il mit légèrement de côté son univers fantastique pour avoir un rendu plus traditionnel, sans pour autant oublier de soigner l’apparence de son film, en capturant magistralement certains instants de cette histoire d’amour à l’aide de cadrages savamment pensés, et d’un sens de la composition tout particulier. En résultent de sublimes plans, qui restent en tête même longtemps après le visionnage du film. Et des plans marquants, le cinéma n’en est pas avare : presque chaque film en possède au moins un, et certains sont devenus aujourd’hui mythiques. Comme autant d'instantanés de films semblables à des tableaux, les “beaux” plans font partie intégrante de notre culture populaire, et on en retrouve dans toutes sortes de films, en prise de vue réelle comme en animation.

Car nous n’en avons pas parlé jusque-là, mais si il y a bien un domaine du cinéma dans lequel la frontière avec le monde de la peinture est infime, c’est celui de l’animation. Qu'elle soit traditionnelle à la main, comme dans les films d’Hayao Miyazaki, ou bien assistée par ordinateur comme dans les productions modernes de studios américains tel que Dreamworks, il n’existe dans les faits presque aucune différence entre les deux médiums : les long-métrages d’animation ne sont en théorie qu’une succession de tableaux, et leur nature même d’images animées réduit encore un petit peu la barrière que l’on peut dresser entre peinture et cinéma. Ces films deviennent presque des peintures animées, et alors il est possible de concevoir toutes sortes d'œuvres, l’imagination étant ainsi la seule limite à la création. De par sa nature, l’animation peut également permettre de s’inspirer plus que jamais d’un peintre : c’est le cas de Kirikou et la Sorcière (1998), réalisé par Michel Ocelot, et dont le style s’inspire énormément des toiles du douanier Rousseau, à tel point qu’il ressemble presque à une version animée de ces dernières par moments.
Sans forcément reprendre l’esthétique d’un artiste en particulier, l’animation peut tout simplement offrir des scènes comparables aux plus beaux tableaux, tant certains artistes du monde de l’animation sont talentueux. Prenons l’exemple de Makoto Shinkai, un réalisateur de films d’animation japonais dont la beauté des paysages a fait la renommée : certains plans de ses films sont magnifiques, et témoignent des mêmes intentions que celle d’un peintre lorsqu’il réalise une toile.
De par sa nature, le cinéma d’animation peut être vu comme le parfait mélange entre le cinéma “classique”, et le monde de la peinture, et s’il obéit aux contraintes et aux règles du premier, il est plus facile pour lui d’emprunter au second, tant la frontière entre la peinture figée et l’image animée est fine.

La précédente image tirée du film Spider-Man : Across the Spider-Verse (2023) est l’occasion de revenir sur la façon dont le travail de la composition d’un tableau est celui d’un plan de cinéma est le même. En effet, ce type de plan, laissant apparaître un ou plusieurs personnages de dos, contemplant la vue devant eux, est très commun, et se base sur les travaux du peintre Caspar David Friedrich. Il a popularisé cette composition, alors nommée en allemand Rückenfigur, traduisible simplement par “plan de dos”, en s’en servant notamment dans le très célèbre tableau Le Voyageur Contemplant une Mer de Nuages (1818). Ainsi, ce tableau servit d’inspiration commune à des dizaines et des dizaines d’autres œuvres, issues du monde de la peinture comme de celui du cinéma. Car il est logique que deux arts partageant en partie les mêmes règles sur certains points, partagent également les mêmes inspirations, et c’est pour cela que certaines œuvres sont des références communes dans ces deux disciplines.


Pour finir, le dernier domaine que nous n’avons pas encore évoqué est celui de la couleur : au cinéma comme en peinture, le travail des couleurs est un art subtil, qui peut grandement influencer la façon dont nous percevons les émotions. Si un peintre, lorsqu’il élabore une toile, réfléchit à une palette de couleur avec laquelle il va travailler, au cinéma, ce rôle est celui de l’étalonneur : il va donner aux différentes scènes du film leurs teintes, en adaptant à chaque situation la palette de couleurs visibles à l’écran. Les exemples sont légions, et le plus connu est peut-être celui de Matrix (1999), réalisé par les Wachowski, dont la teinte verdâtre a énormément marqué les esprits, tout en participant à influencer le cinéma des années 2000. Nous pouvons également citer Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) de Jean-Pierre Jeunet, dont la teinte jaune participe grandement à l’identité du film.

Ce travail sur la couleur, le peintre italien Caravage en a fait sa spécialité, en créant ses œuvres autour d’une palette de couleurs sobre, articulée autour d’effets de lumière importants, notamment en ce qui concerne le clair-obscur, cette technique qui consiste à contraster une partie éclairée à l’aide d’une partie sombre. L’intégralité de son œuvre a été réalisée à la peinture à l’huile, et l’identité visuelle de ses travaux a énormément influencé le cinéma, aussi bien s’inspirant de sa palette de couleurs que de la façon dont celle-ci est au service des effets lumineux.
En l’évoquant parfois directement, le cinéma a toujours été énormément influencé par le monde de la peinture. Partageant avec lui des règles communes en termes de construction d’image et de cohérence graphique, il s’en inspire afin de créer des œuvres nouvelles. Avec l’aide de tous les acteurs de ce milieu, les réalisateurs et réalisatrices du monde entier sont capables d’offrir au public des long-métrages aux visuels travaillés et à l’esthétique marquante, de la même façon que la peinture a été le support d'œuvres qui ont marqué leur époque. Le cinéma n’est pas un remplaçant de celle-ci, simplement une autre forme d’art qui partage avec elle des liens plus forts qu’on ne pourrait le croire au premier abord.



